
6 mai 2021
Dernière mise à jour le Jeudi 6 Mai 2021 à 07:05
Agenda
Tout voirTop 5 - Articles & Vidéos
-

Perpignan : La Ville se mobilise pour la Semaine du Handicap du 14 au 18 novembre
-

Montpellier : Un « nano-robot » entièrement construit à base d’ADN pour explorer les processus cellulaires
-

Montpellier : Le nouveau quartier d'affaires @7 Center est officiellement inauguré !
-

Hérault : FDI Habitat inaugure une nouvelle résidence de 72 logements à Saint-Brès
-

En direct de Toulon pour la SEEPH 2024 : Le Var au cœur de la mêlée





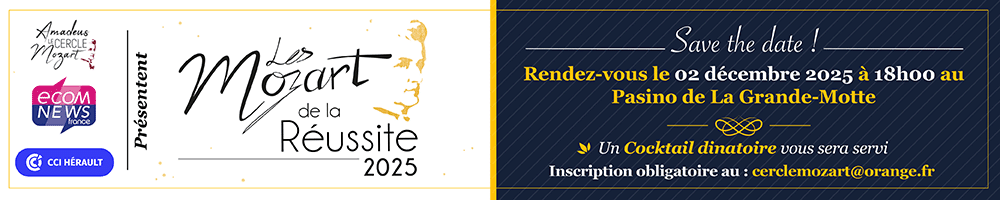

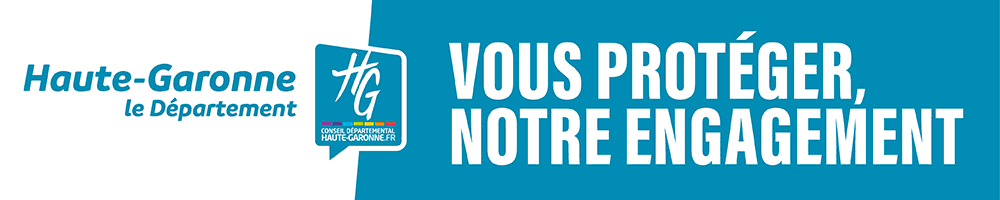
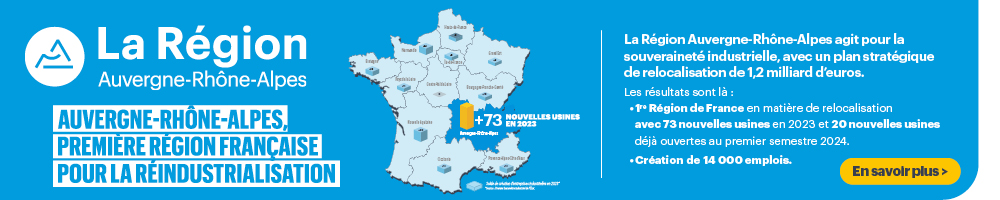
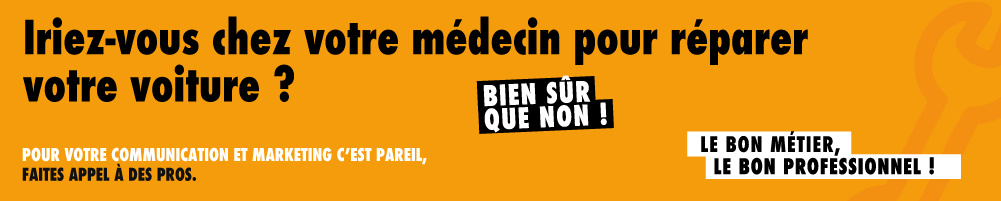
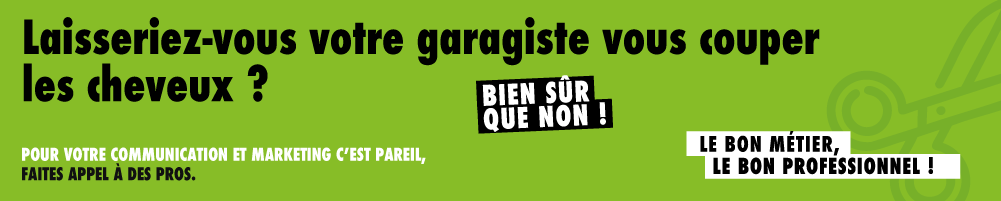



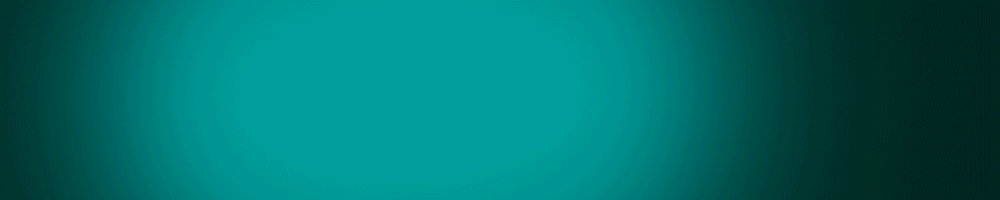
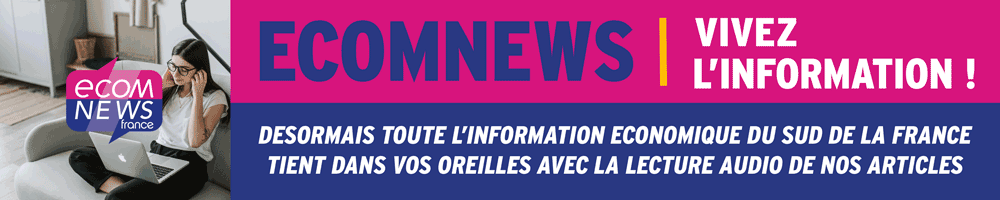
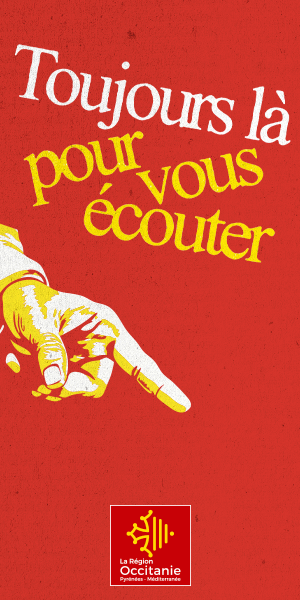
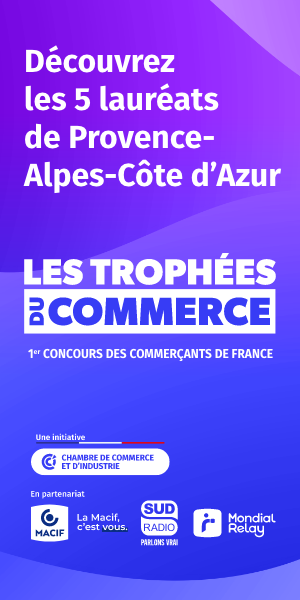
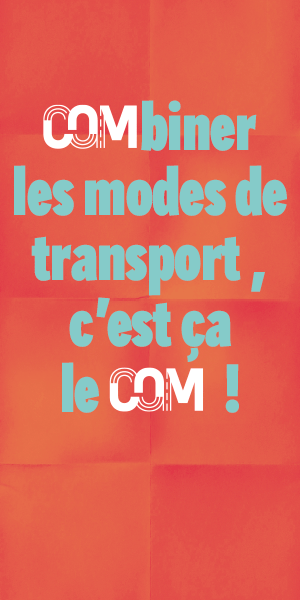

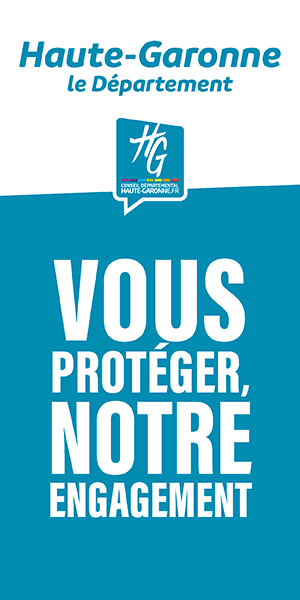
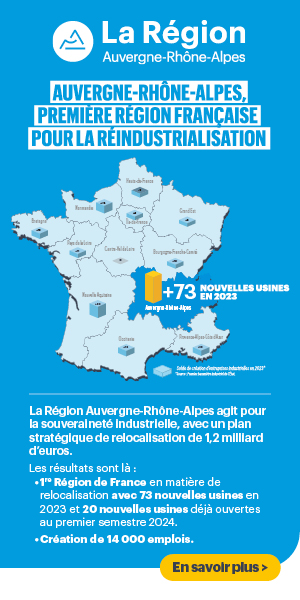
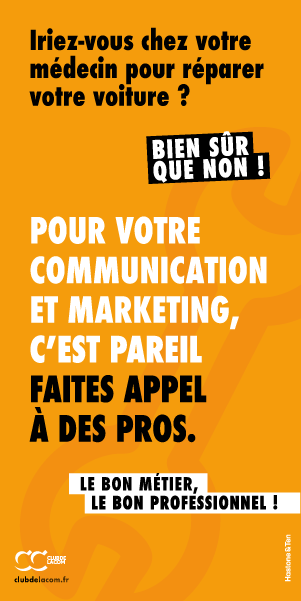
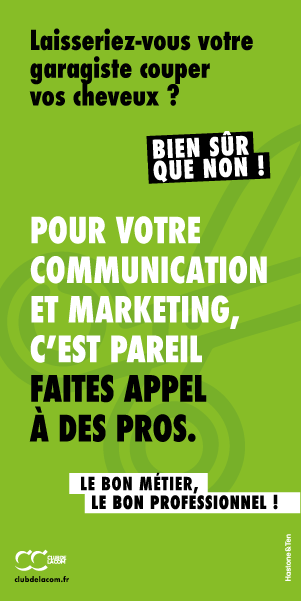

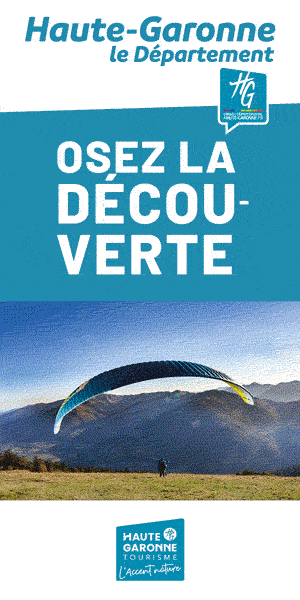
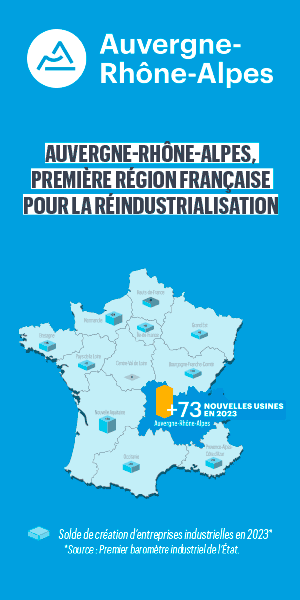

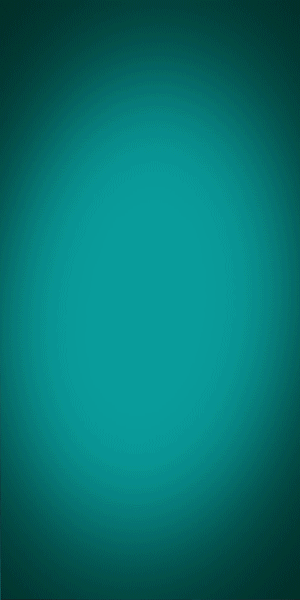



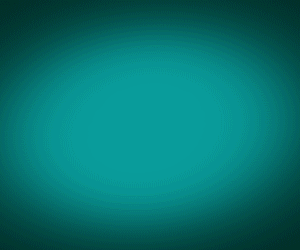




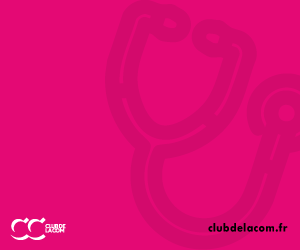

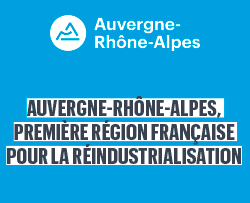



Réagissez à cet article